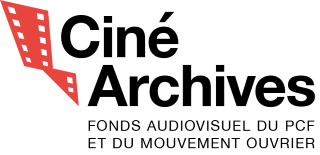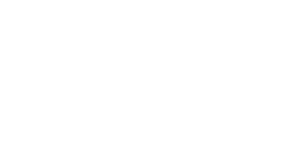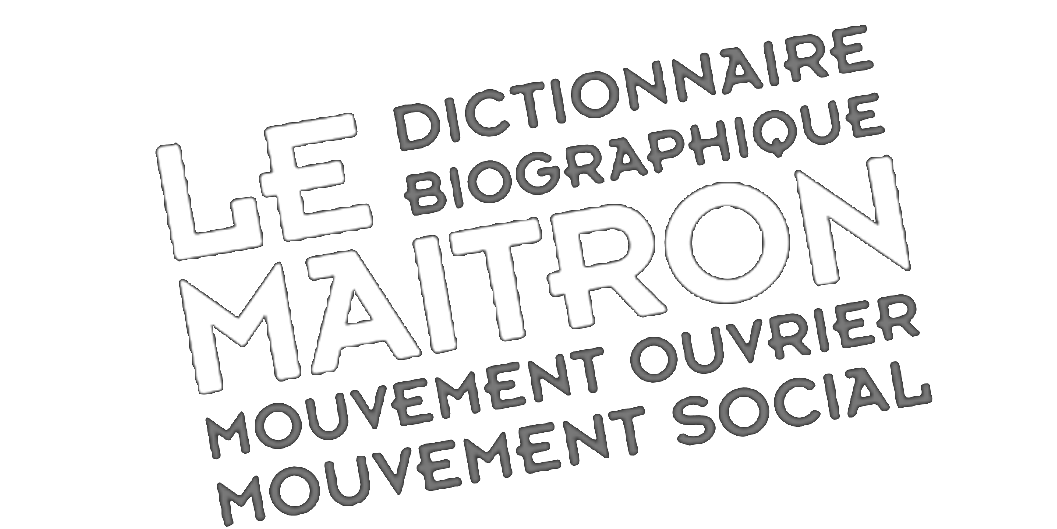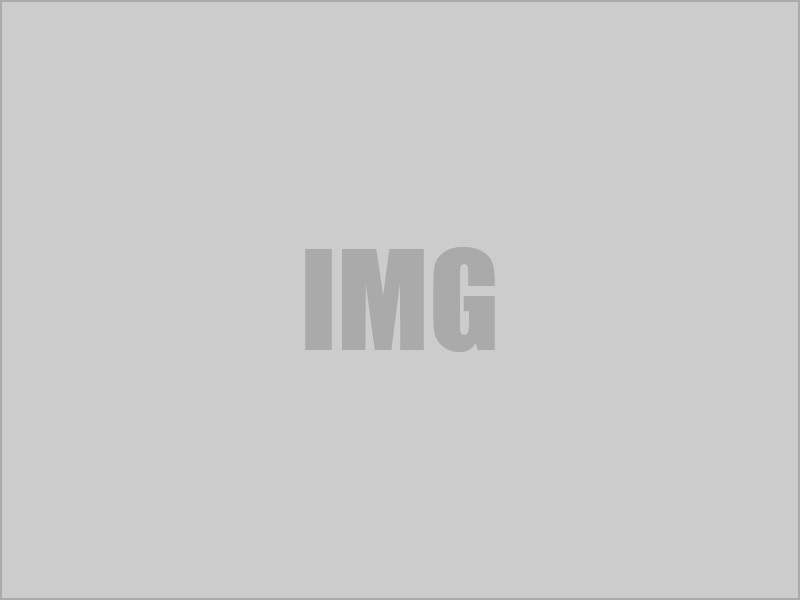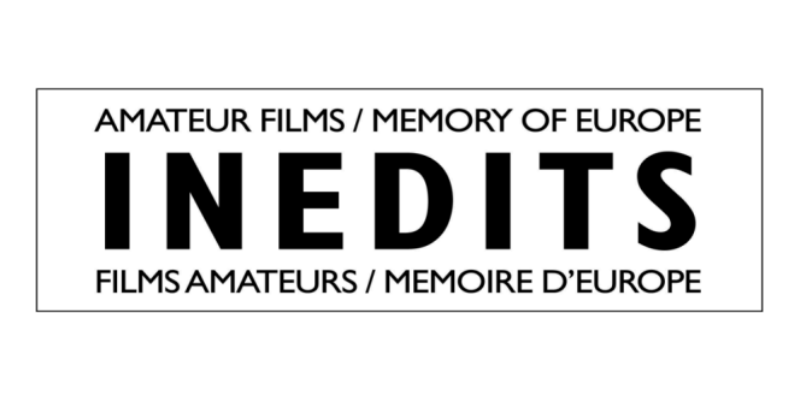|
| Le bolchévique au couteau entre les dents parodié par des ouvriers en grève. "Grèves d’occupation d’usine" (Collectif Ciné-Liberté, 1936) |
La banlieue devient rouge
À l’aube des années 1920, la banlieue se vit à l’ombre ou au large de Paris. Campagnarde, le vert est sa couleur de bonne santé, celle qui donne aux citadins des envies de pavillon. Le noir, volontiers caricatural, représente son urbanisation désordonnée : amalgame de la fumée des usines, de la misère des mal lotis et de la pègre refoulée de la cité. Quant au rouge… Depuis 1871, le rouge de la Commune de Paris a déteint sur ses faubourgs. Il marque aussi certaines communes avoisinantes depuis qu’elles ont élu un maire socialiste. Mais c’est après la révolution russe de 1917 qu’il devient la couleur abhorrée des conservateurs. Dès 1919, à l’occasion des élections législatives, une affiche de grand guignol est placardée en banlieue, représentant un bolchévique rouge sang avec un couteau entre les dents1. Cette image puissante marque les esprits avant même la création de la section française de l'internationale communiste (SFIC).
Elle est renvoyée comme un boomerang par Paul Vaillant-Couturier, cinq ans plus tard, pour saluer la première percée électorale de son parti en banlieue. Son assise y est encore précaire, mais le nouvel élu agite la peur du rouge comme un étendard à la Une de l’Humanité : « Paris est encerclé par le prolétariat révolutionnaire ! »2.
L’affirmation municipale : les films d’Albert Mourlan
Les maires communistes de la banlieue parisienne sont les premiers à utiliser le film pour leur propagande. Ils dénoncent la banlieue noire laissée par leurs prédécesseurs et soignent leur image de bâtisseurs de biens publics, promesse d’avenir pour les banlieues ouvrières. Comme l’est leur politique de l’enfance. Accusées par leurs détracteurs d’être des fabriques d’enfants rouges, les colonies de vacances municipales affichent fièrement leur idéal collectiviste, leur hygiénisme et leurs chants révolutionnaires… Porte-drapeau des mairies auprès de leur population, les colos sont parfois l’unique sujet des films.
Réalisateur non communiste, Albert Mourlan a réalisé la plupart de ces films de commande avant même que le PC ne dispose d’une structure ad hoc de production et de l’engouement des milieux du cinéma pour le Front populaire. Cette initiative de mairies rouges répond sans doute à des utilisations concurrentielles du cinéma de propagande par l’église catholique, la SFIO (Suresnes dispose d’un service municipal cinématographique…) ou encore par les Croix-de-feu. Ces films mettent aussi en valeur l'action des mairies en tant que telle à une époque où le parti communiste refuse la notion même de « communisme municipal », perçue comme un réformisme.
La colo rouge de Gennevilliers.
Extraits du film Les Châteaux du bonheur (Albert Mourlan, 1936)
Une représentation digne des ouvriers contraints à la misère des taudis aux portes de Paris.
Extrait du film Le Temps des cerises (Jean-Paul Le Chanois, 1937)
La classe ouvrière et la ceinture rouge
La dynamique du Front populaire permet au PC et à la CGT de réaliser leurs propres films. Comme les films municipaux, ils dénoncent la pauvreté mais sans stigmatiser les pauvres : pas de banlieue noire à la Zola ou à la Céline dans ces films, pas d’apaches ni de prostitués zonières, pas d’alcoolisme ni de scène de ménage, pas de racisme entre ouvriers… Les travailleurs pauvres, mal lotis ou chômeurs, qui peuplent la banlieue sont avant tout représentés comme des figures de classe. Cette représentation typée et volontariste fabrique autant qu’elle appelle la dignité et l’unité ouvrière sous la bannière du Parti communiste.
Pendant le mouvement de grèves d’occupation d’usines de juin 1936, les techniciens du cinéma se syndiquent en masse et filment leurs studios et leurs laboratoires en grève (Éclair à Épinay-sur-Seine, GTC à Joinville-le-Pont, CTM à Gennevilliers…). Ils tournent aussi dans d’autres usines occupées de la banlieue, comme Renault-Billancourt. La connivence entre grévistes, évidente devant et derrière la caméra, opère alors comme une jonction de classe, incarnant de façon indissociable à l’écran l’avènement de la classe ouvrière et celui de la banlieue rouge.
1 Pour l’analyse de cette affiche, on pourra se reporter à l’article d'Alexandre Sumpf « De l’antibolchévisme à l’anticommunisme », publié sur le site internet L’Histoire par l’image édité par la Réunion des musées nationaux (consulté 25 mars 2014)
2 L’Humanité, 13 mai 1924.