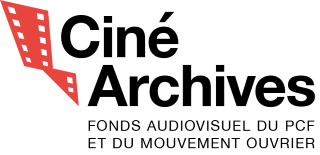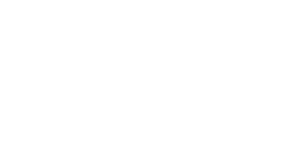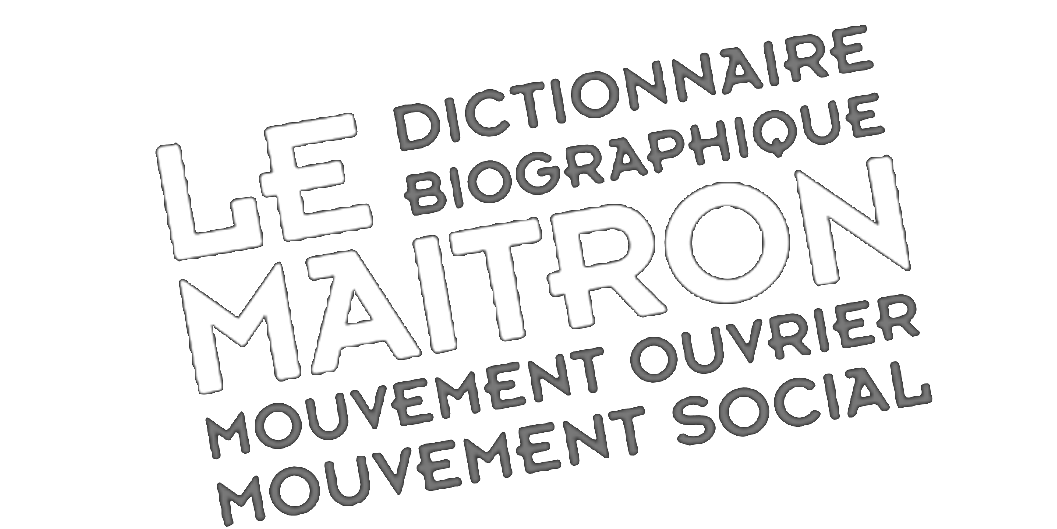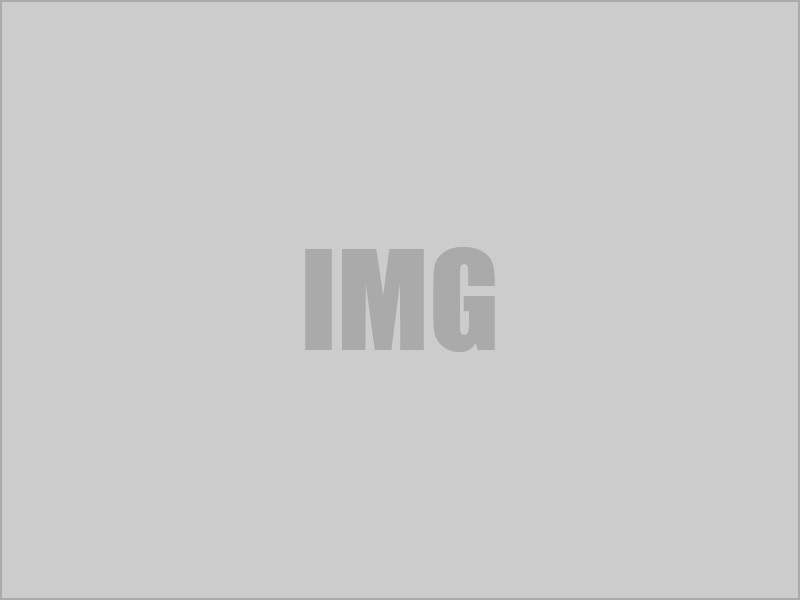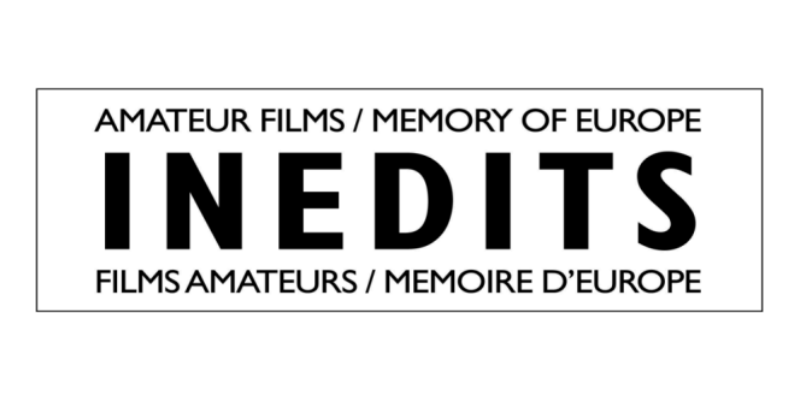|
| Réaménagement de la ville et construction d’une cité HLM à Gennevilliers. Photogramme du film « Gennevilliers, naissance d’une cité » (Louis Daquin, 1964) |
Le tournant des années 60 : la banlieue change de base
La fin de la première phase de la guerre froide et des guerres coloniales augure un changement d’ère pour la société française comme pour le PCF. Son œuvre municipale intégratrice et redistributrice est reconnue alors que la banlieue parisienne est passée en 40 ans de 2 à 5 millions d’habitants !
Lorsque l’État décrète le réaménagement urbain de la région parisienne, les municipalités rouges voient enfin arriver les moyens de résorber la crise du logement qui sévit plus durement qu’ailleurs sur leur territoire (les principaux bidonvilles se trouvent à Saint-Denis, Nanterre et Champigny). Mais elles se battent aussi pour garder le contrôle des projets et des travaux, elles veulent ainsi conserver la maîtrise du sol et du peuplement de leur commune1.
L’édification accélérée de grands ensembles change le visage de la banlieue. En dépit de leur caractère sériel, massif et excentré, les « barres » HLM incarnent l’accès au « confort moderne » pour tous. Certaines municipalités y adjoignent des équipements de culture, comme le théâtre de la Commune à Aubervilliers, qui reste un emblème de l’ambition de décentralisation et de démocratisation culturelle en banlieue rouge.
Dans l’optique du réaménagement de la région parisienne, l’État impulse aussi sa désindustrialisation et, en 1964, un redécoupage électoral qui sépare Paris de sa petite ceinture… et des bastions communistes. Trois nouveaux départements sont créés : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine.
La crise des années 70, l’atteinte au modèle
Dès avant la fin des années 1970, le socle ouvrier de la banlieue rouge est ébranlé par la désindustrialisation : une part cruciale des ressources municipales (la taxe professionnelle) s’évanouit tandis qu’une partie importante de la population ouvrière est crescendo mise au chômage et déqualifiée. La banlieue rouge devient le théâtre de luttes contre la délocalisation de l’appareil industriel : Rateau à La Courneuve, Grandin à Montreuil, Triton à Bagnolet, Chaix à Saint-Ouen… Les municipalités soutiennent activement ces luttes contre la réorganisation du capital au détriment de leur territoire et de leur population, parfois en « gelant » les friches industrielles2.
Mais, face au spectre de la Crise qui s’installe et de la paupérisation qui guette, les maires se résolvent à encourager l’implantation de nouvelles activités de pointe et tertiaires. Non sans débat entre communistes sur ses conséquences, cette réorientation économique est associée à une politique de « mixité sociale » qui allie pratique d’assistance pour les « catégories défavorisées » et développement urbain attractif pour les couches moyennes salariées (qui compte une frange conséquente d'ouvriers qualifiés). L’élargissement du socle sociologique de la ville devient le cœur de la politique municipale : réhabilitation architecturale des centres villes, accès à la propriété, promotion d’une démocratie participative hors du giron traditionnel communiste, etc.
Des ouvriers de l’usine Chausson à propos de la désindustrialisation.
Extrait de La Presqu’Île de Gennevilliers… Aujourd’hui… Demain (Jean-Pierre Riffet, 1974)
Les jeunes et la crise selon la mairie d’Aulnay-sous-bois.
Extrait de Aulnay information : les libertés (Jean-Pierre Galleppe, 1977)
Mutation sociologique
Cette ouverture tentée in extremis par les municipalités communistes vise aussi à conjurer leur érosion électorale car les villes rouges sont confrontées à la montée en puissance d’autres agents sociaux et politiques à la faveur des Trente Glorieuses : la société de consommation et la classe moyenne ont fait éclore des modes de vie et d’engagement incarnés à terme davantage par le PS.
Face à l’hégémonie socialiste, l’échelon communal s’avère être celui qui résiste le mieux. En 1977, porté par l’Union de la gauche, le PCF réalise même son meilleur score aux élections municipales. Cependant, l’amplification de la crise et le tournant de la rigueur pris par la gauche au pouvoir assombrissent l’avenir des classes populaires. Le rétrécissement des voies de l’intégration (et de l’ascension) sociale par le travail touche en particulier les jeunes et les immigrés d’origine ouvrière les moins qualifiés. Au tournant des années 1980/90, les municipalités de la banlieue rouge commencent à ressentir dans les urnes et dans la ville les effets de la désagrégation de leur socle social et identitaire. La désaffiliation militante et populaire dont pâtit le PCF fragilise leur capacité d’encadrement au niveau local. L’abstention devient marquée dans les quartiers populaires, anciennement ouvriers, tandis que la classe moyenne est moins attachée à l'identité ouvrière de la ville et davantage tentée par l'alternance politique.
1 Un débat existe à ce sujet : la politique urbaine du gouvernement a-t-elle imposé des HLM aux municipalités (vidant ainsi Paris de sa population ouvrière) ou bien les maires communistes ont-ils cherché à avoir des HLM…?
2 Jacques Girault signale que l’intervention des communistes (municipalités et conseils généraux) a été l’objet de luttes politiques internes au PCF. À ce sujet, on peut se reporter à sa contribution in Jacques Girault (dir.), Seine-Saint-Denis, chantiers et mémoires, Paris, Autrement, 1998 (coll. « France » N° 16).