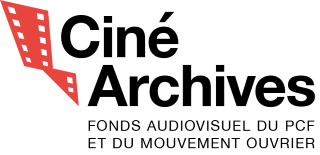Le PCF à la Libération, une force inédite pour une situation exceptionnelle
Par Michel Pigenet
Août-septembre 1944, une légalité nouvelle s’installe les armes à la main. Malgré la confusion inhérente aux circonstances, les forces vives du pays s’accordent sur la volonté de libérer le pays. Le PCF n’y déroge pas. En janvier 1945, il ajuste son mot d’ordre et appelle à « S’unir, combattre, travailler ». Il s’agit de « retrousser ses manches » afin d’armer les combattants et de reconstruire la France. Qui songerait à le contester ? Depuis 1938, la production a chuté d’un tiers dans l’agriculture et des deux tiers dans l’industrie. L’urgence est partout : loger le million de familles sans-abris, garantir les rations sans cesse révisées à la baisse, lutter contre le marché noir, résorber l’inflation qui galope malgré le blocage des salaires et des prix et lamine le pouvoir d’achat.
Le PCF, premier parti de France
Le PCF ne l’ignore pas, mais appuie sans réserve la « bataille de la production ». « Produire d’abord, revendiquer ensuite », prône-t-il, à l’instar de la CGT, où l’on tient la grève pour « l’arme des trusts ». L’heure n’est pas à la révolution, qui défierait dangereusement les priorités militaires du moment et le rapport des forces sociopolitiques. Ne pas viser la conquête du pouvoir n’interdit pas d’occuper le maximum de positions. De retour d’URSS, fin novembre 1944, Maurice Thorez conforte une ligne qui prévaudra jusqu’en 1947.
Auréolé par l’héroïsme de ses militants dans la Résistance et celui de l’Armée rouge sur le front de l’Est, le PCF conjugue conscience de classe et patriotisme. Parti de l’unité et de la Renaissance nationales, il esquisse les contours de « lendemains qui chantent » aux antipodes d’un quotidien de pénuries. Sur ces bases, plus morales que doctrinales, ses effectifs bondissent, mouvement de fond irréductible aux adhésions célébrées de Pablo Picasso, Paul Eluard ou Paul Langevin. L’élan se stabilise autour du palier record de 800 000 membres, atteint à la fin de 1946. Les progrès concernent tout l’Hexagone, mais sont spectaculaires dans la France rurale des maquis. Son audience se mesure aussi à celle d’organisations « amies » : Front national, Union des femmes françaises, Union des jeunesses républicaines de France, issues des Jeunesses communistes. Plus décisive est la conquête de la CGT, qu’amorce en septembre 1945, l’élection de Benoît Frachon à sa tête, aux côtés de Léon Jouhaux. Au congrès d’avril 1946, les communistes détiennent 80 % des mandats des 16 000 syndicats, forts de 4 millions de cotisants. Les ex-confédérés réformistes vivent mal ce bouleversement, mais la CGT conserve son unité.
La gauche politique n’en est pas là, en dépit des discussions engagées sur une éventuelle réunification du PCF et de la SFIO. Aux élections municipales d’avril-mai 1945, la compétition l’emporte toutefois sur les listes communes. Avec 36 515 conseillers, le PCF effectue une percée que confirme l’élection de 1 462 maires – le Parti en annonce 1 999 -, soit quatre fois plus qu’en 1935. En plus des vieux bastions d’une banlieue rouge en extension – 49 des 80 communes de la Seine -, la longue liste des municipalités communistes mêle Marseille, Reims, Limoges, Nîmes, Lens, Denain, Toulon, Ajaccio, Nevers, etc. Ces succès sont confortés aux cantonales de septembre, où il remporte 327 sièges ainsi que la présidence des conseils généraux de la Seine et des Alpes-Maritimes.
Le 21 octobre, les électeurs convoqués pour la désignation de l’Assemblée constituante donnent 5 millions de voix à ses listes – 26,1 % et 11 points de mieux qu’en 1936 – et font du PCF le premier parti de France devant le MRP et la SFIO. Le MRP le dépasse en juin 1946, mais il revient au premier rang le 10 novembre, lors de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la nouvelle IVe République. Les 5,5 millions de suffrages recueillis, soit près 29 %, confortent l’élargissement territorial et sociologique de ses bases. Sans perdre l’ancrage ouvrier, hautement revendiqué, ses progrès parmi le petit peuple des villes et des villages lui composent un profil de parti plébéien.
Les pouvoirs sans le pouvoir
À défaut de prendre le pouvoir, le PCF participe pour la première fois à un gouvernement. Pour le général De Gaulle, qui lui ouvre la porte du Comité français de Libération nationale en avril 1944, son association aux responsabilités procède de l’union nationale des temps de guerre. Au vrai, les deux commissariats attribués à François Billoux et à Fernand Grenier n’ont qu’un lointain rapport avec le poids des communistes dans la Résistance. L’installation du GPRF à Paris ne modifie pas la donne, hormis le remplacement de Grenier par Charles Tillon au ministère de l’Air, Billoux passant à la Santé publique. Sur un total de 23 ministres, c’est peu.
Cantonnée à des ministères « techniques », la présence communiste est plus faible encore au sein des grands corps de l’État en voie de réorganisation. Les élections entraînent un rééquilibrage gouvernemental, mais le général De Gaulle justifie publiquement son refus de confier à des communistes les portefeuilles régaliens des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Intérieur. Après sa démission, en janvier 1946, les partenaires du PCF en tripartisme réitèrent le veto. A plus forte raison s’opposent-ils à ce que Thorez préside le gouvernement.
Dans ce cadre, le PCF concourt aux fondations de la IVe République. Après l’échec référendaire d’un premier projet, où son empreinte était patente, la constitution adoptée en octobre 1946 en conserve des traces dans la définition d’une République « démocratique et sociale » ou le préambule qui affirme, entre autres, la liberté syndicale et le droit de grève. Les communistes ne sont pas moins entreprenants dans l’élaboration de réformes capitales appelées à structurer pour des décennies l’organisation économique et sociale de la France.
En trois ans, d’avril 1944 à mai 1947, douze communistes détiendront un portefeuille. À l’exception de l’éphémère cabinet Blum, presque exclusivement socialiste (décembre 1946-janvier 1947), ils sont de tous les gouvernements. En charge de départements difficiles, dont leurs alliés-concurrents attendent qu’ils s’y embourbent ou s’y déconsidèrent, plusieurs bénéficient d’une relative longévité. Ainsi en va-t-il pour Ambroise Croizat, au ministère du Travail, Maurice Thorez à la Fonction publique, Marcel Paul à la Production industrielle, Charles Tillon à l’Armement ou Laurent Casanova aux Anciens combattants. C’est également le cas de François Billoux à la Santé, mais qui bat le record des postes occupés : Economie nationale, Reconstruction et urbanisme, Défense, intitulé trompeur au demeurant, car il exclut les trois armes – Guerre, Air, Marine…
Souvent dotés d’une solide expérience syndicale, les ministres communistes, rompus à l’appréciation des rapports de forces, sont en première ligne de la vague de nationalisations qui, de décembre 1945 à mai 1946, visent les banques et les compagnies d’assurances, les charbonnages, le gaz et l’électricité. Sur la lancée, ils impulsent l’élaboration de statuts, qui améliorent la protection des personnels. Thorez attache son nom à celui des fonctionnaires, qui garantit la neutralité à travers la reconnaissance de droits, notamment syndicaux, et de déroulement de carrière. Au ministère du Travail, Croizat met en œuvre la Sécurité sociale, dont il élargit le champ et démocratise l’administration, accroît les prérogatives des comités d’entreprises et abaisse le seuil de leur création, s’engage dans la « bataille de la production » et facilite le contournement du blocage des salaires.
Leviers d’une influence au cœur de l’État, les ministres communistes veulent démontrer leur aptitude à servir l’intérêt général. Inédite à cet échelon, l’expérience ne l’est pas au niveau local, terrain de longue date du communisme municipal et outil éprouvé d’implantation du PCF. Les conquêtes de 1945 en étendent le domaine sans en modifier les ressorts. Il s’agit toujours de prouver l’efficacité d’élus « bienfaiteurs et bâtisseurs », ordonnateurs de dépenses sociales traduites en logements, dispensaires, colonies, patronage laïques, cantines, crèches, écoles d’apprentissage. Outre la tutelle préfectorale, le principal obstacle aux ambitions est conjoncturel dans un pays ruiné. Mais le Parti excelle à susciter le bénévolat d’« équipes de choc » affectées au montage de cités d’urgence, à la construction d’équipements de proximité, des abris de bus urbains aux fontaines, lavoirs ou moulins à huile de villages.
Le PCF de la Libération appelle ses militants et ses organisations à être partout les meilleurs. A cette fin, le passé, magnifié, et le présent sont autant de gages pour un avenir que l’on garantit radieux. Au début de l’été 1945, son 10e congrès fixe l’objectif d’avancer le plus loin possible sans épreuve de force. Le socialisme reste l’horizon d’attente, mais le Parti reprend à son compte l’idée d’une « démocratie nouvelle », variante de la « démocratie populaire » que Dimitrov envisageait pour l’Espagne de 1936 et censée faire l’économie de la « dictature du prolétariat ». Candidat à la direction du gouvernement, Thorez confie au Times du 18 novembre 1946 sa conviction qu’il existe d’« autres chemins que celui suivi par les communistes russes ».
Des tensions aux contradictions : vers les ruptures
L’épuisement des compromis sous contrainte de la Libération en décide autrement. Si la Reconstruction progresse à grands pas, les travailleurs n’en perçoivent guère les effets. À l’écrasement du pouvoir d’achat, réduit d’un tiers depuis octobre 1944, s’ajoute la dégradation du ravitaillement. La ration quotidienne de pain chute à 200 grammes en octobre 1947, contre 350 trois ans plus tôt. Le mécontentement social grandit et son expression menace d’échapper aux syndicats. Leurs responsables s’en font l’écho au comité central de mai 1946. Le malaise est flagrant à la CGT, dont la fragile unité vacille. En janvier 1947, son comité confédéral se divise sur deux textes irréconciliables. Au gouvernement, la marge de manœuvre des ministres communistes rétrécit au fil des mois. Chacun de leur côté, le PCF et le MRP aspirent à gouverner sans l’autre, mais avec une SFIO en perte de vitesse et toujours plus réticente au tête-à-tête avec le seul PCF. À travers la question allemande et le conflit indochinois, les tensions internationales annonciatrices de la guerre froide rejaillissent sur les débats franco-français.
En avril 1947, la grève de Renault-Billancourt place le PCF au pied du mur. Sommé de choisir entre deux solidarités, le Parti opte pour la classe et refuse, le 2 mai, d’approuver la politique économique et sociale du socialiste Ramadier. Le 4 et le 5, le Président du Conseil les révoque. Une page se tourne. Sur le moment, beaucoup d’acteurs apprécient mal la portée de la rupture, notamment les dirigeants communistes, certains d’un prochain retour au pouvoir et à leurs conditions.
Michel Pigenet, Professeur émérite à l’université Paris 1