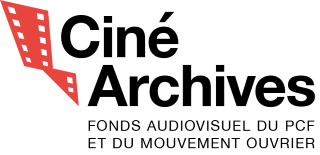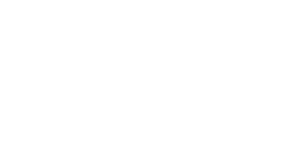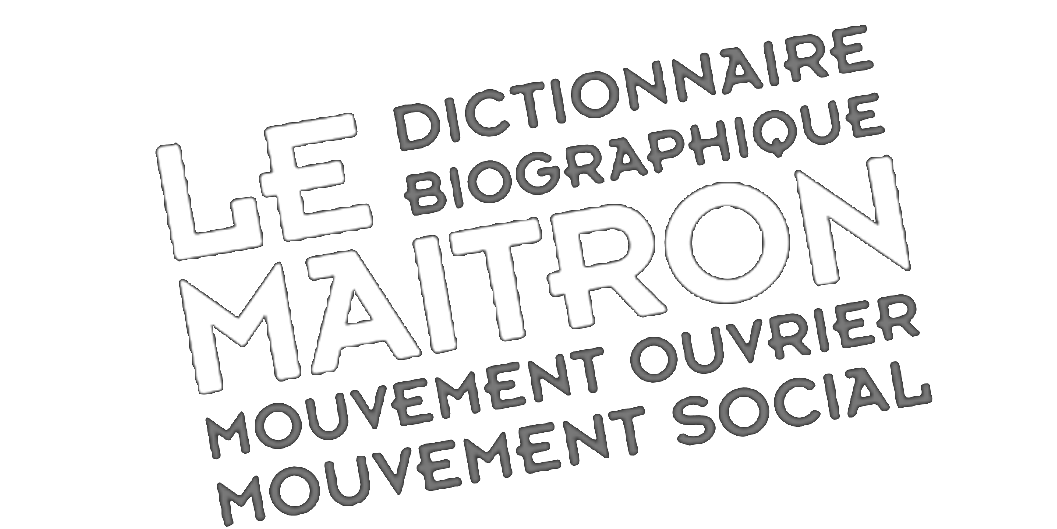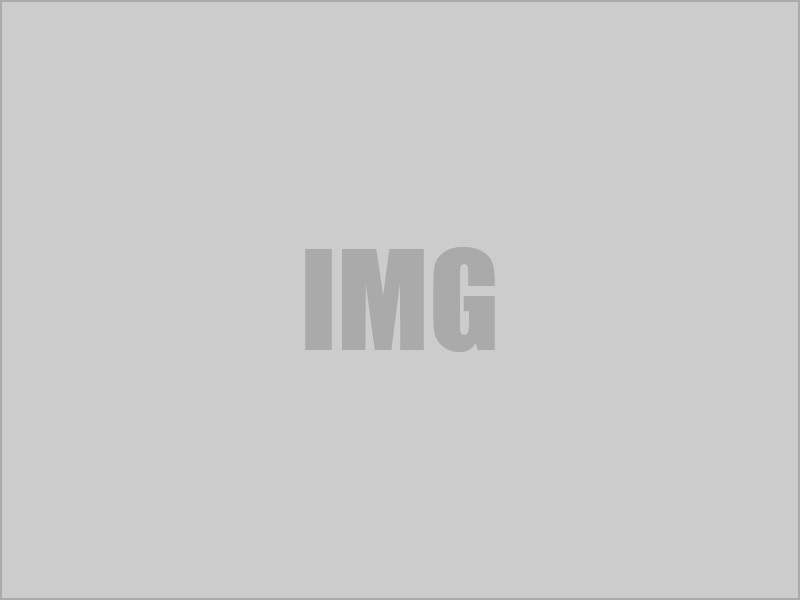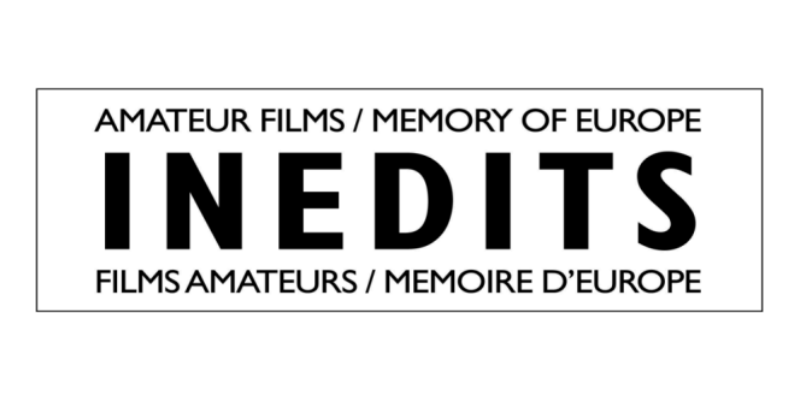La Vie est à nous, film d’actualité
Par Bernard Eisenschitz
Par Bernard Eisenschitz
A l’origine de La Vie est à nous, on trouve Louis Aragon, alors directeur de la toute jeune Maison de la Culture, et Jacques Duclos, responsable de la propagande du Parti communiste français. Dans le souvenir du premier1 :
« Jacques Duclos m’avait demandé conseil : à qui confier la tâche de faire rapidement un film de portée nationale qui servît à préparer les élections, que cela puisse passer dans les cinémas, avec un metteur en scène de grande allure… Je l’interrompis. Oui, je savais qui : Jean Renoir. Thorez consulté, on me donna les mains libres. C’est place de la Madeleine que, le jour même, j’atteignis Renoir. Il était assez surpris, amusé d’ailleurs. Il demanda à réfléchir. La réponse vint le lendemain : c’était un oui. On lui donna trois semaines, un défi. Il en résulta La Vie est à nous. »
Aragon, dans son souvenir, le dit clairement : la décision de faire ce film, le choix de Renoir, ont été artistiques autant que politiques. C’est dans cette double caractéristique qu’il faut voir La Vie est à nous. De son côté, Renoir écrit tardivement, dans Ma Vie et mes Films, avoir accepté la proposition « avec joie » : « Il me semblait que tout honnête homme se devait de combattre le nazisme. Je suis un faiseur de films, ma seule possibilité de prendre part à ce combat était un film. » Pourtant la menace hitlérienne n’était pas seule en cause. Le sentiment d’injustice sociale était présent chez Renoir dès Toni, et les aspects sanglants de la lutte des classes traversent toute son œuvre, quelles qu’aient été ses fluctuations idéologiques.
La production
On est dans les derniers jours de 1935, les élections auront lieu en avril. Tout se passe très vite. Un film comme celui-ci n’a guère de précédent en matière de production, de diffusion, ni dans la volonté de lui donner un caractère collectif. La production, en premier lieu, va être une invention constante : un appel aux amis, militants du PCF, sympathisants ou simples camarades de travail de Renoir, pas de devis, le premier financement réuni par une collecte au cours d’un ou de plusieurs meetings – selon le récit de Jean-Paul Le Chanois, qui vit arriver à son cinquième étage des sacs remplis de pièces ; enfin une nouvelle forme, plus libre, de travail d’équipe. Le même Le Chanois estime le coût à 70 000 francs 1936 (bien sûr, le financement devait être complété par le Parti), qu’on peut comparer à titre indicatif au million du Renoir précédent, Le Crime de monsieur Lange, et aux 200 000 F (d’ailleurs réduits de moitié) du suivant, le moyen métrage Partie de campagne2. Avec cette somme, le dixième d’un budget moyen de l’époque, il s’agit de faire un long métrage, et non un simple catalogue de programme électoral, format dont les films militants devront souvent se contenter. Et il s’agit de travailler dans la rapidité. Renoir comme Le Chanois ont parlé de quatorze jours, l’un pour son propre travail, l’autre pour le tournage ; Georges Sadoul de quatre semaines pour l’ensemble de la production3. Là aussi, c’est une habitude partagée : ce type d’urgence est bien connu des militants – comme des cinéastes.
Jean-Paul Dreyfus, devenu plus tard Jean-Paul Le Chanois, a été l’interlocuteur des « politiques » sur le film et a suivi toute la production. Il travaille dans le cinéma et dans le théâtre (avec le groupe Octobre) et est proche des frères Prévert. Membre du Parti depuis 1933, il tient aussi un rôle administratif important dans la Fédération des théâtres ouvriers de France (FTOF). Au fil des souvenirs, il a attribué l’écriture de La Vie est à nous successivement à Jacques Becker, J.-B. Brunius, Pierre Unik et lui-même ; à Pierre Unik et lui ; à Paul Vaillant-Couturier, rédacteur en chef de l’Humanité et un des responsables de la politique culturelle du Parti, et lui (sans mention d’Unik) ; enfin – hypothèse la plus plausible – à Unik, Renoir et lui, avec une relecture due à l’assistant André Zwobada4. Quant à Pierre Unik (1909-1945), il avait adhéré au PCF en 1927. C’était un des plus jeunes membres du groupe surréaliste, avec lequel il a rompu en 1933 en même temps qu’Aragon, Georges Sadoul et Luis Buñuel. Il est le collaborateur de ce dernier sur Las Hurdes (Terre sans pain, 1933). Paul Vaillant-Couturier l’a fait entrer à l’Humanité en mai 1934. Dans le film, il tient le rôle du secrétaire de Marcel Cachin, directeur du journal. Peu après, il passera à la rédaction en chef de l’hebdomadaire illustré Regards.
Pendant l’écriture, il n’y a ni discussion en comité ni intervention politique directe. « Tout cela a été fait dans la liberté la plus totale. Nous aurions pu ne pas être membres du Parti, Pierre Unik et moi, ou bien être des membres ayant d’autres tendances : personne ne nous a imposé une ligne de conduite. Il y a juste eu une ou deux conversations avec Jacques Duclos, qui nous a indiqué la position du Parti communiste dans le Front populaire et dans la campagne électorale » (Le Chanois). Comme la rédaction du scénario, le film sera d’un bout à l’autre un travail de groupe, d’atelier. Renoir apprécie cette méthode de travail, mais cette fois elle est au service d’un projet politique, qu’il soit perçu comme communiste ou, plus souvent, participant d’un grand mouvement de solidarité et d’antifascisme. On a remarqué la présence, à côté de militants et de responsables du Parti, de « compagnons de route » (Renoir lui-même, dans ces années) aussi bien que de techniciens et comédiens apolitiques faisant confiance au cinéaste. Jacques B. Brunius penchait pour Trotski, d’autres étaient plutôt libertaires, surréalisants, sans étiquette, etc.
Renoir a décrit le film comme « une œuvre collective dans laquelle j’ai plutôt tenu le rôle du producer américain ». La répartition des séquence est la suivante : les séquences « de montage » proprement dites (début et deux premières bobines) sont dues à Brunius ; la vente de l’Humanité, à Henri Cartier ; l’usine, à Le Chanois et en partie à Renoir ; l’ « Histoire d’un paysan », avec Gaston Modot, à Jacques Becker ; l’école et l’« Histoire d’un jeune chômeur », à Renoir, qui a aussi filmé les discours des dirigeants (Vaillant-Couturier, Renaud Jean, Martha Desrumeaux, Cachin, Marcel Gitton, Duclos, Thorez).
Renoir passe bientôt à d’autres projets, tout en continuant de travailler avec le tout nouveau Ciné-Liberté et d’écrire pour la presse communiste. Il a confié le montage à Marguerite Houllé-Renoir, sa collaboratrice régulière et compagne, ce qui confirme l’autorité du « patron » sur tout le trajet du film. La Vie est à nous est présenté le 7 avril, dix jours avant le premier tour des élections, et largement diffusé. Le visa de censure n’est pas demandé, puisqu’il s’agit pour l’instant d’une diffusion militante dans des séances dites privées. Quand il le sera, après les élections, ce sera – de plus – dans le cadre de la lutte contre la censure. Mais le nouveau gouvernement ne tient pas à créer de précédent (craignant de devoir autoriser des films d’autres bords) et lui refuse le visa, tout en manifestant une tolérance pour les projections non commerciales5.
Le film a eu une sortie commerciale « légale » en 1969 seulement. Renoir en a reçu une copie à Los Angeles et l’a vu pour la première fois, avec un plaisir nostalgique, le 2 juillet 19736.
Une culture populaire
Il y a un lien fort entre La Vie est à nous et les manifestations de culture populaire qui sont apparues et se sont développées au cours des années 1920 et surtout avec la crise. Ces formes avaient souvent leur origine dans de petits groupes ou regroupements spontanés, elles étaient indissociables d’un engagement politique ou social. La culture, ici, ne s’entend pas seulement comme culture dite noble, mais inclut aussi l’expression politique : discours, meetings, manifestations, slogans, ces derniers rejoignant une tradition populaire de la comptine, de la chanson et de la satire, et celle, plus récente, du théâtre d’agitation. Le peuple s’approprie des pratiques élitaires en sport ou en musique.
L’agit-prop, venue d’Union soviétique et d’Allemagne pré-hitlérienne, implique des interprètes non professionnels, des sketches et de petites formes scéniques mobiles, sans oublier des chœurs, parlés (agit-prop) ou chantés (chorales). Dès 1931, La Scène ouvrière, organe de la Fédération des théâtres ouvriers de France (FTOF), publiait des scènes et des chœurs parlés de Tristan Rémy, Léon Moussinac ou Béla Balázs. De toutes ces aventures, celle qui a laissé le plus fort souvenir est celle du groupe Octobre, dont le principal artisan est Jacques Prévert (beaucoup de ses membres se retrouvent dans Le Crime de monsieur Lange, écrit par Prévert pour Renoir). Dans La Vie est à nous, des chœurs parlés interviennent à deux reprises, brisant dès les premières minutes le flux de la fiction. Une chorale populaire figure dans l’« Histoire d’un jeune chômeur ». D’autres épisodes aussi doivent leur inspiration à l’agit-prop : sujet de la deuxième séquence mise en scène, les conversations entre des enfants – dont le regard sans maquillage sur la réalité dénonce le discours dominant – en sont parmi les situations récurrentes ; tout comme, plus loin, la vente de l’Humanité et la queue de chômeurs devant la soupe populaire. Les trois séquences sur le directeur de conseil d’administration joueur, interprété par Brunius, ont leur source dans un chœur parlé de Jacques Prévert, Citroën (19337) :
« - Citroën n’écoute pas, / Citroën n’entend pas. / - Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. / Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. / - Un million, monsieur Citroën, un million. / - S’il gagne, c’est tant mieux, c’est gagné, / Mais s’il perd, c’est pas lui qui perd, / C’est ses ouvriers. (…) / Il suffit d’augmenter la cadence / Et de baisser les salaires des ouvriers. »
La caricature de presse est présente avec un croquis de Jean Effel, où son personnage Mathurin tire le portrait des « 200 familles ». Quant à la photo et au photoreportage, ils sont un outil important de la presse progressiste. Dans Regards, contrepartie de l’allemand A-I-Z, ils imposent un nouveau regard des photographes (Capa, Chim, Henri Cartier – futur Cartier-Bresson, qui est de l’équipe de La Vie est à nous) et une nouvelle vision de l’actualité. Une photo des miliciens francistes plusieurs fois publiée (Regards n° 38/70, 5.10.34) est mise en scène à l’identique, et donne lieu à une transition impressionnante : d’une partie de campagne entre grands bourgeois, où on tire sur une « vraie casquette de salopard », à l’entraînement militaire des « hitlériens français ».
Cette culture est aussi une critique des grands moyens d’information : les « sanfilistes » sont regroupés dans l’association Radio-Liberté, qui entend défendre une radio libérée de la dictature des puissances d’argent. L’Alliance du cinéma indépendant (ACI), fondée en novembre 1935, poursuit la diffusion « parallèle » de films entamée avec celle des classiques soviétiques interdits. La critique des actualités cinématographiques n’est pas moins vigoureuse. Ciné-Liberté, journal de l’association née après La Vie est à nous, revient à plusieurs reprises sur la falsification politique qu’elles pratiquent.
La Vie est à nous assure, en même temps que sa tâche de propagande, ce qu’on n’appelle pas encore une contre-information. Il faut réinventer les moyens mêmes du cinéma pour servir le but politique. Les plans d’archives viennent des partis de gauche, d’abord du Service cinématographique socialiste de la Seine, dirigé par Marceau Pivert ; Marcel Carné (parmi d’autres) a filmé la manifestation du 14 juillet 1935 et remis son tournage au PCF ; le jeune assistant Marc Maurette a raconté à Tangui Perron qu’il avait trouvé des bandes d’actualités au marché aux Puces. Quelques plans, empruntés au Nouvelle Terre (Nieuwe Gronden, 1934), de Joris Ivens, sont projetés derrière un personnage en renfort de la fiction ; etc.
Renoir demande à Jacques B. Brunius de monter les séquences « de montage » qui interviennent dans tout le début du film. Brunius a appris des Soviétiques (Eisenstein, Vertov) et de Walter Ruttmann (dans Mélodie du monde) les vertus satiriques du montage : il répète en l’entrecoupant d’autres plans un instant où le chef des paramilitaires Croix-de-Feu, le colonel de La Rocque, ralentit le pas dans un défilé et s’arrête, donnant l’image d’un individu sénile qui fait du sur-place. La caricature s’exerce aussi par le montage audiovisuel : Hitler aboie, les discours de Mussolini déclenchent des bruits de sirènes et de bombes. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, succès récent de Maurice Chevalier, tourne en dérision les Croix-de-Feu. Ces premières séquences font aussi appel à deux truquages optiques coûteux : l’album des 200 familles et la comparaison entre les trois fascismes italien, allemand et français.
L’inspiration n’est pas toujours politique. Les enchères noyautées par les militants communistes de l’épisode « paysan » viennent tout droit de Notre pain quotidien (Our Daily Bread, 1934), un film de King Vidor, grande admiration de Jacques Becker, qui a réalisé la séquence. Choisis dans l’urgence, les interprètes reflètent parfois certains de leurs rôles antérieurs : Jean Dasté, l’instituteur, avait été pion dans Zéro de conduite, film interdit de Jean Vigo ; le couple Julien Bertheau-Nadia Sibirskaïa de La Petite Lise, de Jean Grémillon, se reforme dans l’épisode parisien. Jacques Becker, dans une apparition en chômeur, dit sa nostalgie du cinéma et de Douglas Fairbanks.
Ces emprunts se conjuguent avec des accents propres à Renoir. Le grand renoirien qu’était Claude Beylie voyait dans La Vie est à nous une sorte d’anthologie. Le tir au « salopard » évoque par anticipation la chasse de La Règle du jeu, Brunius au casino préfigure Jouvet dans Les Bas-fonds, l’instituteur du début a sa réponse avec Charles Laughton, entre lâcheté et héroïsme, dans Vivre libre, l’opposition entre le bon ouvrier et le méchant chrono fait écho au duo des mêmes acteurs, Blavette et Dalban, dans Toni… Le choix de l’équipe et des interprètes lui doit beaucoup, qu’ils soient sympathisants ou se soucient peu de la cause du film (comme Nadia Sibirskaïa, qui a raconté avec humour comment il l’avait présentée à Thorez8). Des acteurs de ses films, on retrouve ici ou on reverra une quinzaine.
Un film novateur
Compte tenu des modifications normales dues aux aléas (et à la pauvreté) du tournage, le film suit d’assez près le scénario. Sa construction s’inspire du discours de Maurice Thorez « L’union de la nation française » au 8e congrès du PCF (Villeurbanne, 22-25 janvier 1936). Mais, alors que le discours s’adresse aux militants, le film doit parler aux Français indécis, aux couches et classes dont il faut emporter l’adhésion. C’est par le moyen d’une structure cinématographique ébauchée dès le scénario, dont l’écriture composite articule avec subtilité différentes formes de représentation. Ainsi l’idée d’un film de propagande et présenté au grand public débouche sur des innovations majeures : une forme de production possible qui réinvente ses conditions économiques – par la pauvreté, certes, mais il n’importe – contre l’idée reçue que les coûts entraînés par l’appareillage sonore ont rendu impossible tout cinéma indépendant. « Un film réalisé collectivement par une équipe de techniciens, d’artistes et d’ouvriers », annonce le carton initial. Un film non signé, mais pas anonyme. Le refus du générique traditionnel est justement un des aspects par quoi La Vie est à nous s’inscrit hors de l’« industrie » du cinéma français9.
Autre aspect non moins novateur : La Vie est à nous est sans doute le premier film à confronter matériel documentaire, d’archives, et scènes de fiction, sans dissimuler l’origine de ces matériaux. Les plans documentaires sont donnés pour tels, les fictions pour des histoires. Les glissements successifs de modes narratifs mettent en doute l’idée reçue la vérité absolue du discours ou de l’image.
Dès la première séquence, des plans documentaires présentant une vision statistique et idyllique de la France deviennent, après quelques minutes, le discours d’un instituteur. Ce soupçon envers le discours du pouvoir d’une part, cette relativisation de la réalité absolue des images cinématographiques de l’autre, sont à l’origine des premières séquences. Les rares commentaires de l’instituteur soulignent la relativité de cette vision, en la comparant à la situation de ses élèves. Puis on passe à un dialogue entre les enfants, petite fiction qui bascule elle-même, sur un simple changement de plan, quand un chœur parlé s’adresse au public. Nul doute que Renoir, amoureux de théâtre – et incidemment ami de Bertolt Brecht – a dû apprécier ce changement de registre, qui est vite suivi d’autres.
Représentation, fiction, documents d’actualités, se relaient et s’emboîtent ainsi tout au long du film. Après la dénonciation de la menace fasciste et le récit des émeutes du 6 février 1934, le film s’adresse cette fois au spectateur par trois fictions : l’usine, les paysans, le jeune chômeur. La troisième en particulier, la plus directement ancrée dans la crise, donne un point d’appui concret pour « déboucher tout naturellement » (Sesonske) sur les discours de dirigeants du Parti. Le film est bouclé par un retour sur son ouverture : le défilé final avec l’Internationale réunit les personnages des fictions avec une foule plus vaste, réalisant sur l’écran l’« union de la nation française ». Dans ce finale, certaines images vues précédemment sont remises à leur place, et à travers elles la France rendue aux Français, justifiant l’affirmation propriétaire du titre, « la Vie est à nous ».
Film d’auteur, film politique
Par sa confrontation de matériaux disparates, son analyse des oppositions politiques, sa description – même rapide – de personnages, ouvriers, chômeurs, militants, ignorés du cinéma et de la fiction, par son rejet du pessimisme caractéristique du « réalisme poétique », La Vie est à nous ne ressemble à aucun film de son époque. Comme aucun, il fait comprendre l’enthousiasme que pouvait susciter l’espoir de changement.
Alors que quelques critiques, sur le moment, avaient reconnu sa nouveauté – comme type de production et comme « premier film-essai », selon l’expression de Pierre Bost –, par la suite, et souvent pour des raisons opposées, il a surtout été considéré dans une perspective de cinéma d’auteur. À bon droit. Mais le caractère « collectif » d’un film n’est pas incompatible avec la notion d’auteur de film, et pas davantage avec celle du film d’un auteur. Le Chanois l’a répété : « C’est vraiment Renoir qui a fait le film », et à la vision François Truffaut notait, non sans provocation, qu’« il est aisé de reconnaître sa manière dans le moindre mouvement d’appareil ».
En revanche, sa dimension politique n’a été que rarement envisagée, sinon dans un texte collectif des Cahiers du cinéma, alors proches du PCF, et dans les travaux, non traduits, de Jonathan Buchsbaum. La nouvelle restauration améliore un matériel qui s’était dégradé au cours des années, et rétablit entre autres la continuité de la séquence des vendeurs de l’Huma (due à Henri Cartier). Il est à nouveau temps d’apprécier le caractère exceptionnel de ce film, qui avait fait une « profonde impression » sur le jeune Luchino Visconti. C’est en portant sa date qu’une œuvre peut être actuelle. Les ennemis désignés dans La Vie est à nous sont reconnaissables, et encore familiers aujourd’hui, même si leur menace non moindre prend d’autres formes.
Bernard Eisenschitz
1 ⇡ Cité dans la présentation du film sur la Sept, 1986
2 ⇡ 70 000 francs 1936 équivalent à 50 400 euros
3 ⇡ Renoir dans l’Humanité, 10 avril 1936 ; Le Chanois à Buchsbaum ; Sadoul dans l’Almanach ouvrier paysan, 1937.
4 ⇡ Respectivement : Premier Plan n° 22-23-24, Jean Renoir, Lyon, Serdoc, 1965 ; Guy Braucourt, Jean Renoir et Jean-Paul Le Chanois, Petite histoire de La Vie est à nous, Les Lettres françaises n° 1308, 12 novembre 1969; Jonathan Buchsbaum, Left Political Filmmaking in France in the 1930s, A Dissertation, Department of Cinema Studies, New York University et Philippe Esnault, Le Temps des cerises, Éditions Institut Lumière/Actes Sud, 1996. Un exemplaire du scénario (sans nom d’auteur) se trouve à la Bibliothèque de la Cinémathèque française, Collection jaune, CJ1890 B238.
5 ⇡ Sur cette question mal éclaircie, Pascal Ory a mené l’enquête la plus complète.
6 ⇡ Alexander Sesonske, Jean Renoir The French Films 1924-1939, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1980.
7 ⇡ Reproduit, avec une introduction de Madeleine Rebérioux, dans Le Mouvement social, n° 91, avril-juin 1975.
8 ⇡ Pierre Philippe, Nadia Sibirskaïa ou un certain fluide, Cinéma 61 n° 60, octobre 1961.
9 ⇡ Un générique a été reconstitué en 1969 par l’Avant-Scène, sortant le film en salle, pour l’histoire.