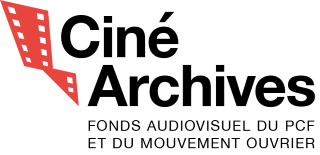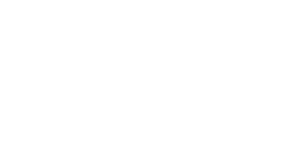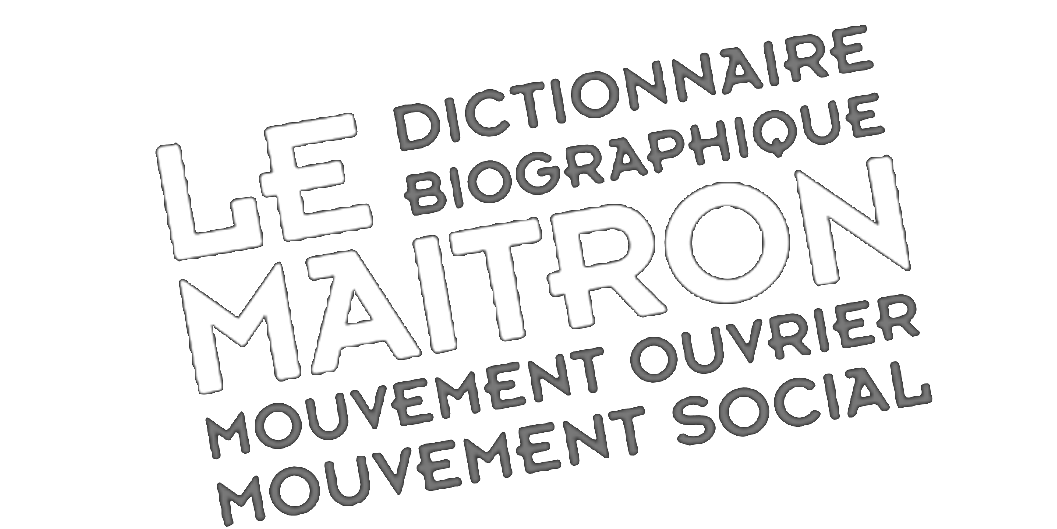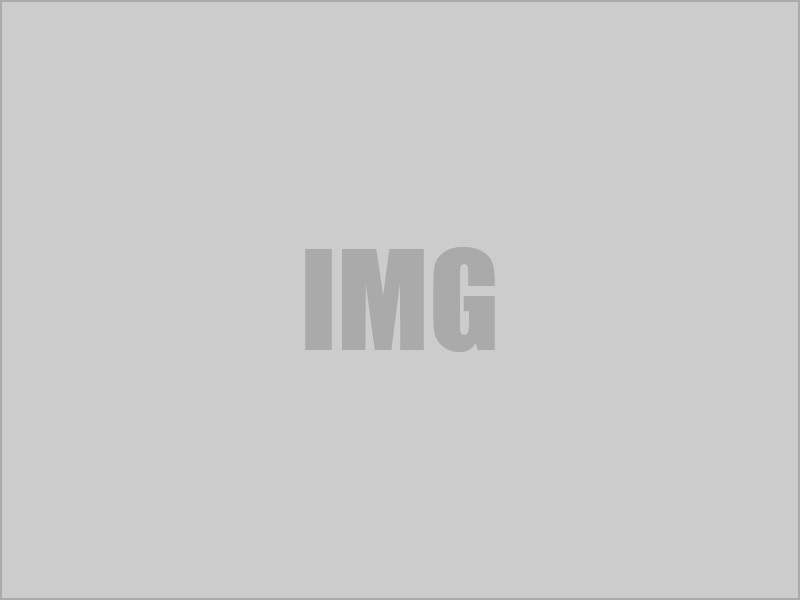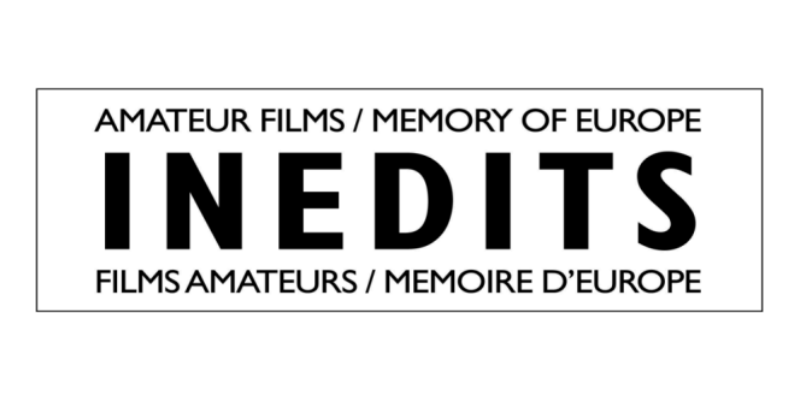Guerre d'Algérie et 1er mai interdit, en quelques fragments de films
Par Marion Boulestreau
Avant d'être rendu à sa vocation initiale de parade militaire, le 14 juillet a constitué un temps fort du calendrier militant, au même titre que le 1er ou le 28 mai - jour de la "montée" au Mur des Fédérés du cimetière du Père-Lachaise, pour rendre hommage aux militant.es de la Commune de Paris et aux victimes de la Semaine sanglante. Cette tradition se perpétuait depuis le 14 juillet 1935, quand des cortèges partis en ordre dispersé pour protester contre la menace fasciste avaient opéré une jonction symbolique dans les rues de Paris, marquant la naissance du Front Populaire.
Aussi, le 14 juillet 1953, les organisations du mouvement ouvrier, PCF et CGT en tête, défilent sur le trajet emblématique "Bastille-Nation". Derrière le cortège syndical, plusieurs milliers de militants nationalistes algériens du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) ferment la marche. Ils scandent "A bas le colonialisme" et divers mots d'ordre en faveur de l'indépendance. A l'arrivée place de la Nation, alors que le gros de la manifestation a déjà commencé à se disperser, la police exige le retrait du portrait de Messali Hadj, le dirigeant du MTLD, alors emprisonné. Les manifestants refusent, la police charge, la manifestation se transforme en émeute, la police ouvre le feu sans sommation. Sept personnes meurent sous les balles, six militants du MTLD et un militant de la CGT. Plus de quarante sont blessées par les coups de feu et coups de matraques. A l'exception de quelques titres de la gauche communiste (L'Humanité) ou catholique (Témoignage chrétien), la presse dans son ensemble tait l'événement, quand elle n'accuse pas les victimes. La mémoire de cette journée se perd très rapidement, et n'a refait surface que récemment, grâce aux travaux de Danielle Tartakowsky, Emmanuel Blanchard, Alain Ruscio et Daniel Kupferstein, auteur de Les balles du 14 juillet 1953 - Le massacre policier oublié de nationalistes algériens à Paris.
Cette guerre d'Algérie qui ne dira jamais son nom n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour, mais dans un contexte politique de plus en plus tendu, le Ministère de l'Intérieur et la préfecture décident d'interdire tous les défilés dans Paris. Quelques rares manifestations seront de fait tolérées, mais c'en est fini du 1er mai et du 14 juillet - du moins, sous leur forme classique.
Le 1er mai 1954, pour contourner l'interdiction, le Paris ouvrier se rassemble dans la clairière de Reuilly, à l'orée du bois de Vincennes, à l'appel de la CGT et du PCF. Un caméraman du parti est présent. Les rushes tournés ce jour-là, non montés, sont conservés par Ciné-Archives ; ils montrent la foule nombreuse massée autour d'une estrade, ornée de drapeaux rouges et tricolores. A la tribune, des dirigeants d'envergure nationale et des figures parisiennes se relaient : la direction du parti est représentée par Jeannette Vermeersch et Jacques Duclos, qui encadrent Raymond Guyot (secrétaire de la fédération de Paris du PCF) ; Benoît Frachon (secrétaire général de la CGT) laisse la place à Eugène Hénaff, secrétaire de l'union des syndicats de la Région Parisienne. Au loin, perdue dans la foule, on distingue une très large banderole du MTLD, ornée d'une effigie de Messali Hadj. La caméra lui consacre un plan quelques instants plus tard ; on voit très nettement le groupe compact des militants du MTLD, arborant au revers de leur veste un insigne avec le visage de Messali Hadj.
Le 1er mai 1955, le rassemblement, qui se tient de nouveau au même endroit, est encore filmé. La caméra s'attarde sur les visages de vieux travailleurs en casquette et d'enfants. Des jeunes gens dansent une ronde. Soudain surgissent dans le champ des banderoles « À bas le statut de l'Algérie », « L'indépendance de l'Algérie est inéluctable », « Vive le mouvement national algérien ». La scène dure à peine trois secondes, puis l'opérateur baisse sa caméra et cesse de filmer.
Ce passage est curieux : trop court pour témoigner d'une envie d'accorder trop d'importance à ces revendications, mais trop long pour laisser croire à un accident, puisqu'on a le temps de lire les inscriptions sur les banderoles. Les porteurs de ces banderoles ne sont pas identifiables ; il s'agit selon toute probabilité de partisans du MNA (Mouvement National Algérien, issu du MTLD disparu à la fin de l'année 1954), principal rival du FLN (Front de Libération Nationale). Les images suivantes montrent les orateurs de la CGT à la tribune et la foule nombreuse dans la clairière ; elles ne laissent plus de place aux slogans nationalistes.
Le 1er mai 1956, les opérateurs du PCF et la CGT sont à nouveau dans le bois de Vincennes. Cette fois, aucune trace de revendications indépendantistes algériennes. La seule allusion au conflit tient en trois mots entraperçus : "Paix en Algérie". Mais il s'agit là du mot d'ordre officiel adopté par le PCF, pas d'un slogan des nationalistes algériens. Il est d'ailleurs "noyé dans la masse", à la fin d'une banderole de 4 lignes demandant l'unité syndicale et l'augmentation des salaires.
Les années qui suivent, le rassemblement n'est pas filmé - il faut dire que cette période est compliquée pour les sociétés cinématographiques liées au PCF, et que la production est plus ou moins mise en sommeil vers le milieu de la décennie.
Quant au défilé du 1er mai, il faudra attendre 1968 pour voir à nouveau des manifestant.e.s battre le pavé de la capitale.
Ces images entrevues des revendications du peuple algérien sont rares et précieuses à plus d'un titre. Jamais, on s'en doute, de telles images n'auraient été filmées par les Actualités françaises ; pas étonnant donc qu'il faille les chercher dans les archives militantes. Toutefois, l’ambiguïté de la position des communistes français sur l'indépendance de l'Algérie laisse songeur sur le statut de ces fragments. On ne sait pas si l'irruption de ces revendications est un incident que la caméra se contente de tolérer, ou un acte concerté qu'elle soutient en le filmant. La récurrence de ce surgissement en 1954 et 1955 irait plutôt dans ce sens. D'ailleurs, on peut noter une évolution : en 1954, la séquence est assez longue et les militants du MTLD font l'objet d'un portrait de groupe, quand le jaillissement des banderoles de 1955 a des allures plus clandestines. Ces images n'ont jamais été vues à l'époque : au milieu de la guerre froide et des luttes d'indépendance, le cinéma militant vivait alors des moments difficiles, se heurtant à des problèmes financiers et à une censure accrue. Les films produits par les sociétés proches du PCF et de la CGT trouvèrent de plus en plus difficilement le chemin des salles, et en 1956 la production était tombée à son niveau le plus bas.
Cela explique sans doute que les rushes tournés ces jours de mai 1954 et 1955 n'aient pas été montés, comme beaucoup d'autres rushes conservés par Ciné-Archives.
Mais le hasard n'explique pas tout. Le PCF a consacré beaucoup d'énergie à combattre de façon claire et virulente la guerre d'Indochine, consacrant plusieurs films aux héros de la lutte anticoloniale, Henri Martin et Raymonde Dien. Pour l'Algérie en revanche, la position du PCF fut plus équivoque, et tout en menant campagne contre la guerre, il ne se prononça pas clairement en faveur de l'indépendance. Dans ce flou, et si l'on ajoute le poids des contraintes matérielles et de la censure, il était difficile, on le comprend, de produire des films abordant le sujet. C'est pourquoi la guerre d'Algérie est peu présente dans les films conservés par Ciné-Archives - à l'exception notable du film sur les obsèques des victimes de Charonne, en février 1962, mais cette fois-ci, il devenait évident que la guerre touchait à sa fin ; de plus, le profil même des victimes, toutes membres de la CGT et du PCF, facilitait l'appropriation de cet événement tragique par le mouvement ouvrier français.
Au-delà de la guerre d'Algérie, on notera que les travailleurs d'Afrique du Nord, pourtant nombreux à Paris à cette époque, sont peu présents dans les films du PCF et de la CGT. Là encore, c'est vers les matériaux bruts qu'il faut se tourner pour les voir surgir en masse, comme dans le film de 1952 Obsèques de Hocine Belaid. Algérien, père de famille, cet employé communal d'Aubervilliers a été tué par la police lors de la manifestation contre la venue en France du général Ridgway. Les images tournées le jour de son enterrement montrent une foule de visages d'amis, collègues et camarades, dont beaucoup sont ces immigrés qu'on cherche en vain dans les films de l'époque.
 |
| Obsèques de Hocine Belaïd, 1952 |
Peu "aimables" (car muets, fragmentaires, décousus...), aux marges d'un cinéma militant lui-même marginal, les rushes, longtemps négligés réservent encore beaucoup de découvertes aux historien.ne.s.
Texte rédigé par Marion Boulestreau, responsable de Ciné-Archives, initialement publié sur le blog Mediapart de Ciné-Archives en mai 2020.